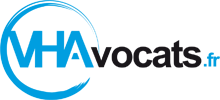D'abord l'imposition à un taux forfaitaire proportionnel a été remplacée par l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ensuite a été créé un abattement pour durée de détention, d'une part pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (de nature à gonfler les plus-values) et d'autre part pour favoriser les détentions longues et ainsi l'épargne de long terme.
Le Conseil d'Etat par une décision du 12 novembre 2015 a précisé les règles d'imputation des moins-values sur les plus-values mobilières.
L’introduction de l’abattement pour durée de détention ne s’est pas faite sans poser certaines difficultés au regard notamment de l’imputation des moins-values sur les plus-values de même nature. En effet, afin de favoriser les prises de risque dans les investissements, la loi prévoit la possibilité d’imputer les moins-values d’une année sur les plus-values de même nature et de la même année ou bien encore des dix années suivantes (on parle alors de moins-values en report).
L’Administration fiscale a fait une articulation très contestée des deux mécanismes. Elle considérait qu’il fallait d’abord appliquer l’abattement sur les plus-values et sur les moins-values de l’année. Qu’il fallait ensuite imputer les moins-values de l’année sur les plus-values de l’année. Et enfin il fallait imputer les éventuelles moins-values en report.
Il était donc appliqué les abattements pour durée de détention sur les moins-values, qui s’en trouvait diminuée d’autant. Ainsi, une moins-value de 100 constatée sur des titres détenus depuis plus de 8 ans ne sera prise en compte qu’à hauteur de 35 pour s’imputer sur des plus-values ayant ou non bénéficier de l’abattement pour durée de détention.
La position de l’administration avait sa logique, elle voulait notamment éviter qu’une véritable plus-value nette ne soit pas imposée. Ainsi, un contribuable qui réalise une plus-value de 200 bénéficiant d’un abattement de 50% et une moins-value de 100 sur des titres avec une durée identique à celle des premiers, ne supporterait aucune imposition, s’il n’était pas appliqué d’abattement sur la moins-value, alors qu’il a réalisé véritablement une plus-value.
La doctrine administrative vidait quelque peu la loi de son objet et pouvait conduire des contribuables à céder des titres en moins-value latente avant qu’il soit appliqué un abattement pour durée de détention.
Un recours pour excès de pouvoir a été porté devant le Conseil d’Etat à l’encontre de la doctrine administrative selon laquelle l’abattement pour durée de détention s’appliquait aux moins-values était illégale.
Par une décision du 12 novembre 2015, le Conseil d’Etat est venu donner tort à l’administration et a fourni une nouvelle lecture de la loi.
Il convient de suivre un raisonnement en trois étapes.
D’abord on constate la plus-value et le taux de l’abattement pour durée de détention applicable (sans l’appliquer néanmoins).
Ensuite, il convient d’imputer sur la plus-value, une moins-value de l’année ou antérieure.
Enfin, on applique l’abattement sur le solde.
Ainsi, le Conseil d’Etat considère que l'abattement ne s’applique qu'au montant de la plus-value qui subsiste après que le contribuable a imputé les moins-values dont il dispose.
Par ailleurs le Conseil d’Etat consacre une grande liberté quant à l’imputation des moins-values, le contribuable peut choisir d’imputer les moins-values sur les plus-values les moins abattues et pour le montant qu’il souhaite.
Par cette décision, le Conseil d’Etat met fin au risque de cession précoce pour éviter les abattements pour durée de détention sur les moins-values.
Mais il en résulte une conséquence défavorable pour le contribuable. En effet, comme l’abattement s’applique sur le solde de plus-value après l’imputation des moins-values, il faudra imputer davantage de moins-values pour anéantir toute imposition (au titre de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, l’abattement n’étant pas pris en compte pour calculer l’assiette de ces deux dernières impositions). Et dés lors que le contribuable aura réduit à néant son assiette taxable, en raison de moins-values, il perdra nécessairement le bénéfice de tout abattement.
Compte tenu du principe de l’opposabilité de sa propre doctrine à l’Administration, il ne semble pas qu’elle puisse s’essayer à rectifier les impositions des années non prescrites pour lesquelles la nouvelle règle serait plus défavorable au contribuable.
A contrario, il peut s’avérer judicieux pour le contribuable de reconsidérer sa situation aux vues de la nouvelle interprétation du Conseil d’Etat afin de savoir si elle lui est plus favorable et de procéder le cas échéant à une réclamation auprès de l’administration dans le but de s’en prévaloir.
Toutes nos simulations fiscales
>> Simulation acquisition immobilière
>> Simulation charges sociales
>> Simulation donation cession d’entreprise
>> Simulation IR
>> Simulation CEHR
>> Simulation Plus-value mobilière
>> Simulation Plus-value immobilière
>> Simulation CIMR - Prélèvement à la source
Dossiers - Fiscalité
Optimisation fiscale cession entreprises
Les différentes possibilité d'optimiser la fiscalité sur la cession d'entreprise
Optimiser la fiscalité de la cession d’entreprise par une donation (Partie 1/2)
Optimiser la fiscalité de la cession d’entreprise par une donation en chiffres (Partie 2/2)
Acquisitions immobilieres
Fiscalité de l’investissement locatif professionnel : Modalités d’acquisition
Valorisation de l’usufruit de parts de SCI, les problématiques en suspens
Valorisation de l’usufruit temporaire et détermination de sa valeur économique
Quel régime fiscal choisir pour un investissement locatif ?
Nos schémas d’optimisation fiscale d’acquisition immobilière
Calcul des plus-values immobilières
Quel avenir pour le démembrement temporaire de propriété ?
Acquisition en démembrement : Il va être difficile d'acquérir un usufruit temporaire.
Le démembrement de parts de SCI
Le démembrement de propriété comme moyen d’acquisition d’immobilier d’entreprise (Partie 1/2)
Le démembrement de propriété comme moyen d’acquisition d’immobilier d’entreprise, en chiffres (Partie 2/2)
Acquisition d'immobilier d'entreprise, quelle solution choisir ?
Regularisation fiscale
IR 2020 : Case 8UU ou 8TT pré-cochée ? Le fisc certainement informé de l’existence d’un compte à l’étranger
Comptes étrangers non déclarés découverts par l’administration : Cas du Crédit Suisse
Echange automatique d'informations et échange de renseignements en matière fiscale
Notre intervention et nos honoraires pour le traitement d’une régularisation fiscale de compte à l’étranger
Modalités pratiques de la régularisation fiscale
Exemples du coût de la régularisation fiscale des comptes à l’étranger
Régularisation fiscale des comptes bancaires étrangers
optimisation remuneration des dirigeants
Les aspects retraite et prévoyance sur le choix du régime social du dirigeant
Optimisation de la rémunération du dirigeant
La SAS à l’IR
Choix entre la flat tax (Prélèvement Forfaitaire Unique PFU) ou barème progressif de l’IR ?
Rémunération des dirigeants et flat tax sur dividendes
Rémunération du dirigeant - Choix du statut social et dividendes
Optimisation de la rémunération du gérant majoritaire de SARL
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et possibilités de dégrèvement sur 2011
Charges sociales sur dividendes, la transformation en SAS, fausse bonne idée
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et revenus exceptionnels
Conseil et actualites
Les exonérations de l'Impot sur la Fortune Immobilière (IFI) : les biens immobiliers d'entreprise
L'Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Prélèvement à la source et année blanche : Le CIMR
Comment optimiser le prélèvement à la source et l’année blanche
Le prélèvement à la source
Calcul et imposition des plus-values mobilières
Fiscalité des SCI